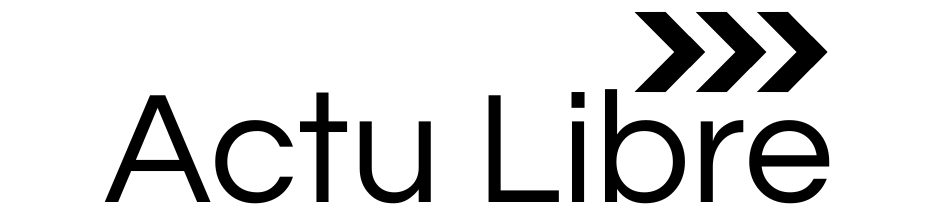Contestations persistantes aux États-Unis : entre apparences calmes et mobilisation croissante
Washington paraît calme, en apparence. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le président signe des décrets controversés et des entorses institutionnelles. Les mobilisations majeures de 2020, après la mort de George Floyd, semblent désormais loin.
Selon un sondage publié la semaine dernière, Donald Trump demeure l’un des présidents les moins populaires de l’histoire moderne, avec 44% d’approbation. Un léger rebond attribué au cessez-le-feu obtenu à Gaza n’efface pas ce score historiquement bas à ce stade de son mandat.
Une peur diffuse freine l’action sur le terrain
Sur le terrain, la contestation existe, mais elle se manifeste de manière discrète: banderoles, autocollants sur les pare-chocs, petits rassemblements étudiants.
« Nos étudiants ont peur. Ils ne savent pas quelles actions pourraient leur causer du tort », affirme Cyrus Hampton, professeur de sociologie et de littérature américaine à l’université Howard.
À l’Université Howard, surnommée le Harvard noir, un groupe d’élèves a protesté le mois dernier contre le déploiement de la garde nationale à Washington. Mais seuls quelques dizaines d’étudiants et étudiantes dispersés autour d’une oratrice au mégaphone étaient présents. Aucune interview n’a été accordée et les médias n’étaient pas les bienvenus, notamment par crainte de représailles.
« Nos étudiants ont peur », résume Cyrus Hampton dans l’émission Tout un monde. « Ils se sentent menacés, ils ne savent pas quelles actions pourraient leur causer du tort ou faire que leurs noms se retrouvent entre de mauvaises mains », ajoute-t-il.
Pour lui, le malaise est profond. « On a l’impression d’un effondrement du système. Beaucoup de responsables politiques suivent le mouvement ou ne s’y opposent pas franchement. Même moi, je suis pris de court », ajoute-t-il.
Des mobilisations plus dispersées mais plus nombreuses
Cette peur ne fait pas taire la contestation. « Le public américain n’est pas un bloc uniforme », rappelle Dana Fisher, professeure à l’American University et spécialiste des mouvements sociaux. « Les minorités hésitent à participer, car elles sont directement visées par l’administration Trump. Mais dans des villes comme Chicago, les gens se mobilisent parce qu’ils se sentent moralement obligés de réagir », analyse-t-elle.
« Si les Américains ne se réveillent pas, on fonce droit dans un tunnel obscur. Tout le monde doit être dans la rue », déclare Mike Churchill, militant démocrate.
Aux côtés de lui, Amber, militante, décrit une résistance réelle mais plus éclatée. « À l’époque de Black Lives Matter, on sortait tous ensemble. Aujourd’hui, il y a des petits foyers partout. C’est plus dispersé, mais il y a autant de monde qu’avant », affirme-t-elle.
Un mouvement plus fort qu’auparavant, malgré la dispersion
Les travaux de Dana Fisher confirment cette impression: « Il y a cette fois plus de monde dans les rues que lors du premier mandat de Trump. Mais la mobilisation est plus décentralisée », explique-t-elle.
Début juin, des manifestations ont eu lieu dans près de 2000 villes lors du No Kings Day, une journée symbolique contre la dérive autoritaire du président. « Des millions de personnes étaient présentes. » Le No Kings Day 2, qui a eu lieu samedi à travers les États‑Unis, a rassemblé environ sept millions de personnes, selon les organisateurs.
« On voit naître une véritable capacité civique dans les communautés, là où la politique se joue vraiment », affirme Dana Fisher. Selon elle, cette mobilisation locale rend le mouvement plus fort et non plus faible.
Le spectre de la répression et les incertitudes politiques
Reste une question: la Maison Blanche tolérera-t-elle longtemps cette contestation ? À Chicago, les forces fédérales ont déjà recours à des méthodes musclées pour disperser les manifestants, rappelant les scènes de l’été 2020: gaz lacrymogènes, hélicoptères à basse altitude, arrestations arbitraires.
« Si le scénario se répète, des affrontements risquent d’éclater », avertit Dana Fisher. « J’aimerais croire qu’il ne faudra pas une guerre civile pour en sortir, mais cela suppose que des Républicains s’opposent à cette prise de pouvoir », ajoute-t-elle.
Pour l’heure, les fissures restent invisibles dans un Parti républicain verrouillé par l’opportunisme. Mais selon plusieurs observateurs, la tolérance croissante envers la violence politique traduit un malaise démocratique profond.