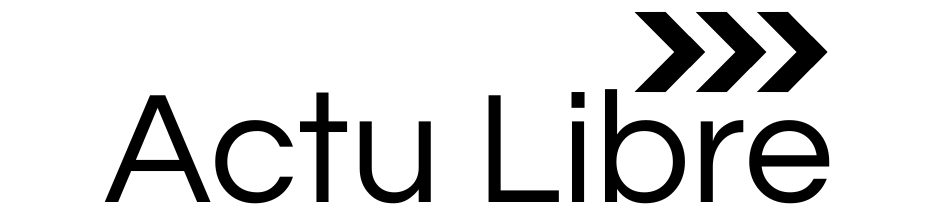Gabriel Galice : la paix ne se décrète pas, elle se constate et le rôle de l’ONU au cœur du processus
Contexte et premières réactions autour du cessez-le-feu
Éléments positifs et zones d’ombre
Selon Gabriel Galice, l’arrêt des massacres serait une avancée évidente, mais plusieurs zones d’ombre subsistent. Il relève notamment l’absence de consultation de l’ONU et l’absence d’invocation de la responsabilité de protéger. « Cet accord s’est fait entre Trump et Netanyahu, deux dirigeants qui n’ont pas un passé de paix », a-t-il précisé dans La Matinale.
Rôle international et intervention américaine
Il rappelle que les États‑Unis ont envisagé d’envoyer des forces pour superviser le cessez-le-feu, une tâche normalement confiée à l’ONU. « Ce n’est pas la compétence de Washington de ramener la paix dans le monde », affirme-t-il.
À titre de contexte, l’armée israélienne a annoncé l’entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza et le retrait de soldats de plusieurs zones.
Les dynamiques diplomatiques et les signaux sur le terrain
Acteurs et signaux inquiétants
Un mois à peine avant l’annonce, Israël avait bombardé les négociateurs du Hamas à Doha. « Ce ne sont pas des signes de confiance tout à fait positifs », observe Galice, qui évoque aussi ce qu’il appelle le « jeu trouble » de certains acteurs, notamment Tony Blair, pressenti pour superviser la seconde phase du plan.
Évolution du Hamas et prudence nécessaire
Quant au Hamas, décrit comme « détruit » par Israël, il convient de demeurer prudent. « Quand on tue un combattant, on en fabrique dix », estime Galice, soulignant que la logique de la violence se nourrit d’elle‑même. Il faut attendre et voir si la libération des otages israéliens sera suivie d’actes équivalents, comme une éventuelle libération de Marwan Barghouti, qui serait un vrai signe d’ouverture. Pour le moment, on n’en est pas là.
« La paix ne se décrète pas dans un accord, elle se constate. C’est une vertu, un état d’esprit de confiance. Et à Gaza, la confiance a été détruite », rappelle Gabriel Galice, président de l’Institut international de recherche pour la paix à Genève.
Les défis persistants pour la question palestinienne
Au-delà du cessez-le-feu, la question palestinienne demeure entière. « Où va‑t-on mettre les Palestiniens ? » s’interroge le spécialiste. « La Cisjordanie continue d’être grignotée chaque jour par des colons soutenus par l’armée israélienne. » Au sein du gouvernement Netanyahu, certains ministres tiennent aussi des propos suprémacistes.
Selon lui, la question du droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes est fondamentale. « La paix ne se décrit pas comme un simple accord ; elle relève d’un état d’esprit de confiance. »
Réhabiliter le rôle de l’ONU dans le processus
Face à un processus de paix largement piloté par les États‑Unis, l’expert appelle à réhabiliter le rôle de l’ONU. « Ce n’est pas l’institution qui est en cause, mais l’usage qu’en font les grandes puissances qui ont bloqué sa machinerie depuis la fin de la guerre froide », affirme-t-il. Plusieurs résolutions appelant à un cessez-le-feu à Gaza ont été bloquées par le veto américain, la dernière en date remontant au 19 septembre.
À Gaza, la population aspire avant tout à survivre après deux années de guerre. « Les peuples savent qu’ils paient la guerre : de leur sang, de leurs impôts, de leurs conditions de vie ou de mort. Et ils ne sont ni idiots ni masochistes. Globalement, ils veulent vivre, tout simplement », affirme le spécialiste.
Pour l’heure, dans les ruines de Khan Younès ou de Rafah, la paix n’a pas encore émergé comme une réalité.
Propos recueillis par Pietro Bugnon/hkr